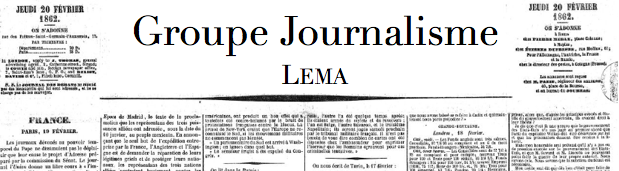Le reportage dérive d'un genre littéraire beaucoup plus ancien : le récit de voyage. Depuis la Renaissance, des écrivains retracent leurs expéditions qui ont généralement une portée initiative. Il existe ainsi tout un sous-genre prolifique du "Voyage en Italie", illustré par Montaigne, Goethe (père et fils), Chateaubriand, Stendhal et même le marquis de Sade — sans compter les déclinaisons musicales de Franz Liszt ou Mendelssohn. Au début des années 1840, des journaux commencent à commander des récits de voyage à des écrivains : il s'agit d'une conséquence logique de l'intégration des formes littéraires dans la presse à l'image du roman-feuilleton. Théophile Gautier rédige ainsi pour La Presse un Voyage en Espagne dès 1840. D'autres initiatives similaires suivront (dont un voyage en Allemagne et l'immuable voyage en Italie).
Le récit de voyage ne constitue pas encore un reportage. Si le narrateur va sur le terrain et est tenu à une publication régulière (ce dont Théophile Gautier se plaint souvent), son voyage n'est lié à aucune actualité. Le pittoresque et l'ordinaire tiennent au contraire une place prépondérante : Gautier ne vient pas en Espagne pou couvrir un événement ou une série d'événement mais juste pour… aller en Espagne.
Par contraste, le reportage est toujours lié à la couverture d'une certaine situation politique voire guerrière et est très étroitement lié aux nouvelles techniques de transmission de l'information. Pour Marie-Ève Thérenty, le reportage « invente une poétique médiatique qui coïncide avec l’essor du journal d’information. » Il s'agit d'un genre d'abord anglo-saxon avant de s'acclimater rapidement en France. La Guerre de Crimée de 1853 est le premier exemple emblématique : les journalistes Roger Fenton et James Robertson sont dépêchés sur place et donnent un compte-rendu suivi du déroulement de la guerre. Le terme "reporter" est intégré en France au cours des années 1870, avec une définition initialement péjorative. Pour le dictionnaire Larousse de 1875, « Le mot anglais reporter, que notre langue s’est approprié, signifie proprement raccoleur de nouvelles. La France doit à l’Angleterre ce type de journaliste à qui les jambes sont plus indispensables que le style. »
Il y a pourtant des continuités : les premiers reporters sont presque toujours des littéraires, généralement spécialisé dans la rédaction de récits de voyage. En 1859, Amédée Achard couvre ainsi la campagne d'Italie pour le Journal des débats. Malgré sa formation littéraire, Achard inaugure un style très différent de Théophile Gautier mettant l'accent sur la transmission de "faits" et, en accord avec l'esthétique propre aux écritures de l'information, raccourcit et "compacte" ses phrases pour gagner en efficacité. Tous les autres précurseurs du reportage sont des "écrivains-reporters" : Albert Wolff pour la guerre austro-prussienne de 1866 ou Edmond About qui rédige son "journal de journaliste" pendant la guerre franco-allemande de 1870.
La guerre russo-turque de 1877 entraîne la généralisation du reportage dans les grands titres français : ils commencent tous à employer des journalistes spécialisés (et non juste des correspondants ponctuels). À partir de cette date, la professionnalisation du statut s'accélère. Le télégraphe joue un rôle déterminant dans cette autonomisation par rapport au champ littéraire (et aux autres formes de journalisme). Il est en soi un sujet majeur du reportage, à l'image de l'article de Gaston Leroux sur la "Russie coupé du monde" lors de son reportage sur la guerre russo-japonaise, puis la guerre civile russe de 1905. Il constitue l'outil déterminant dont le reporter doit savoir se saisir pour transmettre l'information avant tout le monde et déjouer les contraintes de la censure. Car les lignes télégraphiques restent détenu par les autorités publiques, qui "reformulent" fréquemment les dépêches envoyées pour éviter, par exemple, la divulgation de secrets militaires. Face à ce contrôle, les reporters élaborent des tactiques, à l'image de ce journaliste américain qui emploie le message codé « Automobile n°404 arrivée à Paris » pour annoncer avant tout-le-monde la mort du pape Léon XIII.
L'infrastructure technique affecte directement le "style" du reportage et la manière dont il tente de se valoriser en tant que genre journalistique. Les reporters revendiquent un statut d'observateur objectif. Edmond About se définit comme un "microscope" : « Je ne sais si le lecteur excusera ces observations microscopiques, mais je suis l’indigne élève de mon ami Charles Robin, et j’estime que la vie des sociétés, comme celle des individus, ne confesse ses secrets qu’au microscope ». Les formules télégaphiques, considérées comme l'archétype du "fait brut", constituent un modèle stylistique puissant : dès le début des années 1870, Ludovic Halévy utilise des phrases très courtes ; le reportage de Gaston Leroux sur le Russie coupé du monde prend la forme d'un assemblage de dépêches.
L'accent mis sur l'objectivité est cependant contrebalancer par la situation souvent dangereuse voire dramatique du reporter. Pour Pierre Giffard, qui publie le premier essai d'héroïsation du reportage, Le Sieur de va-partout, l'idéal est de « faire le compte rendu d’une catastrophe dans laquelle on est tué ». Dans des contextes aussi difficiles, le reporter peine à se maintenir dans un statut de "pur" observateur. L'écrivain Pierre Loti dénonce ainsi les horreurs de la guerre coloniale en Indochine dans Le Figaro : ces écrits font scandale et son reportage s'interrompt prématurément. Albert Londres ne procèdera pas différemment : son reportage sur Cayenne est envisagé dans la perspective de la fermeture du bagne.
Enfin, même s'il se présente comme un travail spécialisé d'écriture de l'information, le reportage ne rompt pas tous les liens avec la littérature. Certains grands reporters, comme Gaston Leroux, se reconvertissent finalement dans une carrière littéraire (qui contribue à "littérariser" la figure du reporter, à l'image du double de Leroux, Gaston Rouletabille). Inversement, la professionnalisation de cette activité n'empêche pas les journaux de toujours faire appel à des écrivains, qui se prête généralement au jeu — à l'image du reportage de Guy de Maupassant sur les conflits coloniaux en Algérie pour Le Gaulois. La littérature peut également inspirer directement un reportage. En 1901, Le Matin et Le Journal financent un tour du monde en 80 jours par deux de leurs journalistes, Gaston Stiegler et Henri Turot. Jules Verne lui-même salue cette transposition revendiquée de son roman Le Tour du Monde en 80 jours dans la réalité.