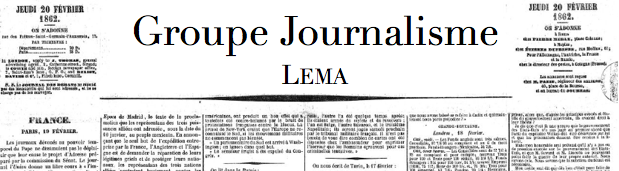Poésie
Tout au long du XIXe siècle, la presse publie fréquemment de la poésie. Ces formes courtes circulent aisément d'un journal à l'autre : le projet fugitive verse permet ainsi d'identifier un grand nombre de reprises dans la presse américaine (le même phénomène se produisait probablement dans la presse française).
Pour des poètes modernes comme Baudelaire, le périodique s'impose comme un lieu de diffusion privilégié. La plupart des poèmes des Fleur du mal ont d'abord paru dans la presse depuis 1845 (dans leur première édition) et il en va de même pour le Spleen de Paris.
Au sein de cette production, une forme se détache : le poème en prose. Initialement expérimentée par quelques romantiques (Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand), elle devient emblématique d'une hybridation croissante entre écritures poétiques et écritures journalistiques. Le poème en prose se coule en partie dans le moule de la chronique et des "choses vues" boulevardières (voire du fait divers). Cette adaptation est cependant pensée sur le mode de la subversion. Comme le note Marie-Ève Thérenty, "Le poème en prose arrache la chronique à l’éphémère, à la péremption, à l’actualité, car la recherche formelle dérobe la nouvelle au champ de l’information et du fugace pour lui donner une sorte d’éternité"
Le genre reste vivace jusqu'à la fin du XIXe siècle. De mai à décembre 1882, Théodore de Banville publie une série de "Tableaux rapides" tous les vendredi dans Le Gil Blas. Banville prend en compte d'emblée les conditions de lecture du support : dans l'avant-propos il indique qu'il veut une lecture de "deux minutes". Toujours en 1882, Octave Mirbeau diffuse ses poèmes en proses dans Le Gaulois.
Le poème en prose s'apparente à une forme d'analogue, pour la poésie, du feuilleton pour le roman : une recréation journalistique de codes littéraires destinée à être lue par un public élargi. Sa postérité est cependant bien plus limitée. Les nouvelles écoles poétiques de la fin du XIXe siècle (symbolistes, décadents), adoptent des formats beaucoup plus hermétiques, préférentiellement diffusées dans des petites revues littéraires ayant des tirages limités