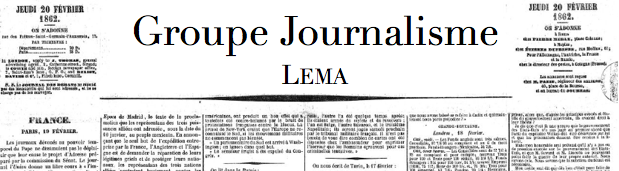Jusqu'à la Seconde République la critique perd de l'importance dans le journal au profit de la fiction (même si apparition de nouvelles formes de critiques comme la critique musicale). Pendant le Second Empire, la critique conserve une place importante mais elle change de forme : sous l'effet de la censure elle devient un lieu de contestation occulte. On assiste à un « exode » de la critique du périodique généraliste vers les périodiques spécialisés (comme le supplément du dimanche du Figaro) à partir de la IIIe République. L'un des lieux communs consiste alors à déplorer la mort de la critique.
La Critique n'est pas une rubrique homogène. Elle se décline notamment sous trois formes:
- La Bibliographie : c'est juste une recension rapide d'un ouvrage (avec les métadonnées et une petite notice de présentation, le tout faisant rarement plus de quelques lignes). La Bibliographie s'inscrit dans la continuité d'une activité ancienne (qui remonte notamment au Journal des sçavants, qui paraît à partir de 1665). Elle entretient des liens étroits avec la réclame et la publicité, le journal se contentant souvent de reprendre ce que dit l'éditeur. Le genre est revitalisé à la fin du siècle quand la critique "développée" disparaît : Le Matin publie « Les Livres » à partir du 11 août 1884.
- La Variété : il s'agit d'un article de fond à portée didactique, voire scientifique, usuellement publiée en "haut" du journal. Les critiques de la presse contemporaine dérivent principalement de cette forme.
- Le Feuilleton : il prend la forme d'une libre "causerie" entre un journaliste et son public. La littérature ou les arts ne sont souvent qu'un prétexte pour introduire des sujets plus larges (à portée sociale ou politique). Sainte-Beuve publie ainsi ses "causeries du lundi" dans le Constitutionnel vers 1840-1860 : son compte-rendu des Mémoire d'outre-tombe a une portée beaucoup plus politique que littéraire.
Au-delà de sa capacité à faire ou défaire les carrières (que soulignait bien Illusions perdues de Balzac), la critique joue un rôle important dans la structuration des écoles artistiques. La naissance du naturalisme est ainsi en grande partie "orchestrée" par une controverse entre Ferragus (pseudonyme de Louis Ulbach) et Zola dans le Figaro. Les journaux apprécient de leur côté ces batailles littéraires et artistiques, prétextes à feuilletons médiatiques.