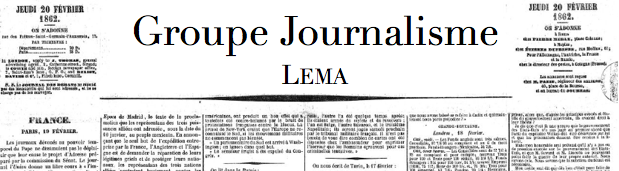Le fait divers dérive d'une forme beaucoup plus ancienne : le canard. Dès le XVIIe siècle, les almanachs relaient tout un vieux fond d'histoires plus ou moins vraisemblables (cf. l'Histoire du Canard rédigée par Gérard de Nerval). Vers 1830-1840, À cet époque, l'élaboration de ces proto-fait divers est plutôt un travail de compilation de récits plus ou moins récents (souvent effectué par une agence de presse comme Havas).
Les premières rubriques de "fait divers" apparaissent en 1837 dans La Presse : elles couvrent un ensemble de brèves sans classification précises, généralement liées à des catastrophes naturelles mais pas toujours. Le crime est principalement traité par le reportage judiciaire. Vers la fin des années 1840, de premiers feuilletons médiatiques criminels commencent à apparaître, mais toujours en dehors de la rubrique fait divers, à l'image de l'Affaire Combette, largement relayée dans le Journal des débats
Lors de la création du Petit Journal, les faits divers sont toujours aussi vagues. Ils prennent leur sens moderne à la faveur de l'affaire Troppmann. Thomas Grimm privilégie un traitement empathique qui rencontre un succès extraordinaire : le tirage passe de quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'exemplaires. Les premiers grands faits divers, fortement narrativisés, viennent se substituer dans la presse populaire naissante au roman-feuilleton : le feuilleton criminel de Troppmann tient tout autant en haleine que les Trois Mousquetaires trente ans plus tôt.
Par la suite, les "fait-diversiers" se détournent de ce traitement trop empathique et privilégient au contraire des phrases courtes et formatées. La profession journalistiques trouve alors sa spécificité (par rapport aux autres métiers de l'écrit) dans l'emploi privilégié de techniques d'information et de tournures normalisées. Fénéon est l'un des spécialiste de ces formes brèves, extrêmement condensés, qui ne renoncent cependant pas tout à fait à certains effets de style (notamment la distanciation ironique). Des rédacteurs sont entièrement affectés à la Préfecture de police pour récupérer des nouvelles intéressantes puis se rendent sur le terrain. Il existe une « halle aux faits divers » dans la boutique d'un marchand de vin en lisière de Paris. Graduellement, les journalistes font eux-même leurs enquêtes et montent leurs réseaux d'information.
Le fait divers contribue à la démocratisation de la presse. Ses "personnages" principaux couvrent en effet la totalité des milieux sociaux et participent d'une forme d'héroïsation de la vie quotidienne